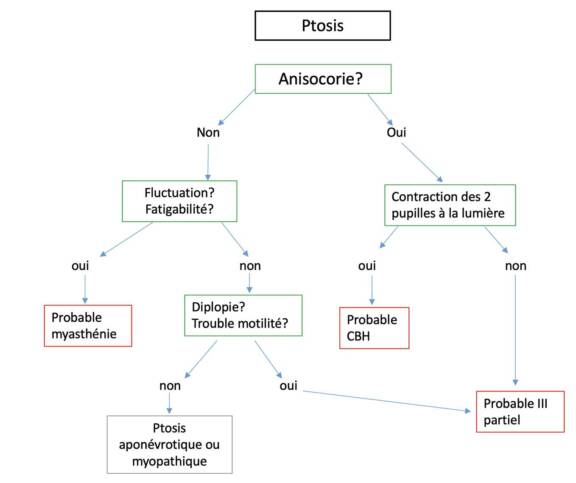Échos Neuro-ophtalmologie
Comme chaque année, divers domaines de la neuro-ophtalmologie ont été abordés lors de la session du Club de neuro ophtalmologie francophone (CNOF). Il a notamment été question des troubles visuels d’origine cérébrale et des nouveautés. Ces troubles visuels d’origine cérébrale, bien que rares, sont importants à reconnaître car ils nécessitent une prise en charge adaptée.