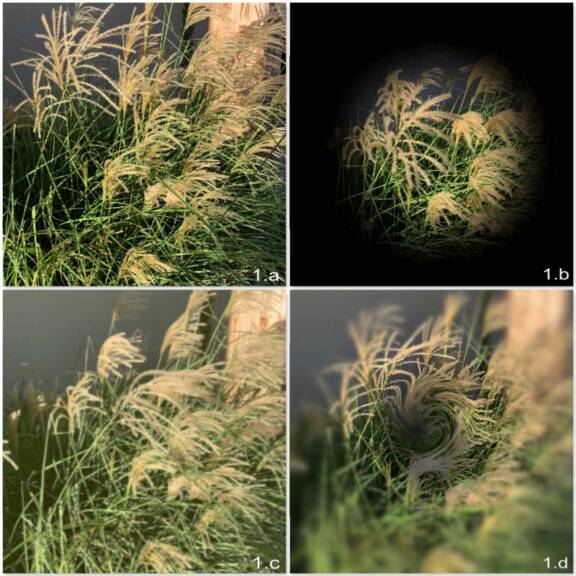Applications de la télémédecine en ophtalmologie et présentation d’une expérience en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
La télémédecine est définie par l’Organisation mondiale de la santé comme l’échange d’informations médicales à distance via des méthodes de communication numérique dans le but d’améliorer l’état de santé d’un patient. Nous présentons dans cet article un état des lieux des applications de la télémédecine en ophtalmologie, de ses modalités pratiques et du cadre réglementaire à ce jour, et enfin une expérience de téléophtalmologie en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) réalisée sur l’ensemble du territoire français.